C'est le temps du maïs
C'EST LE TEMPS DU MAIS
Septembre 2013
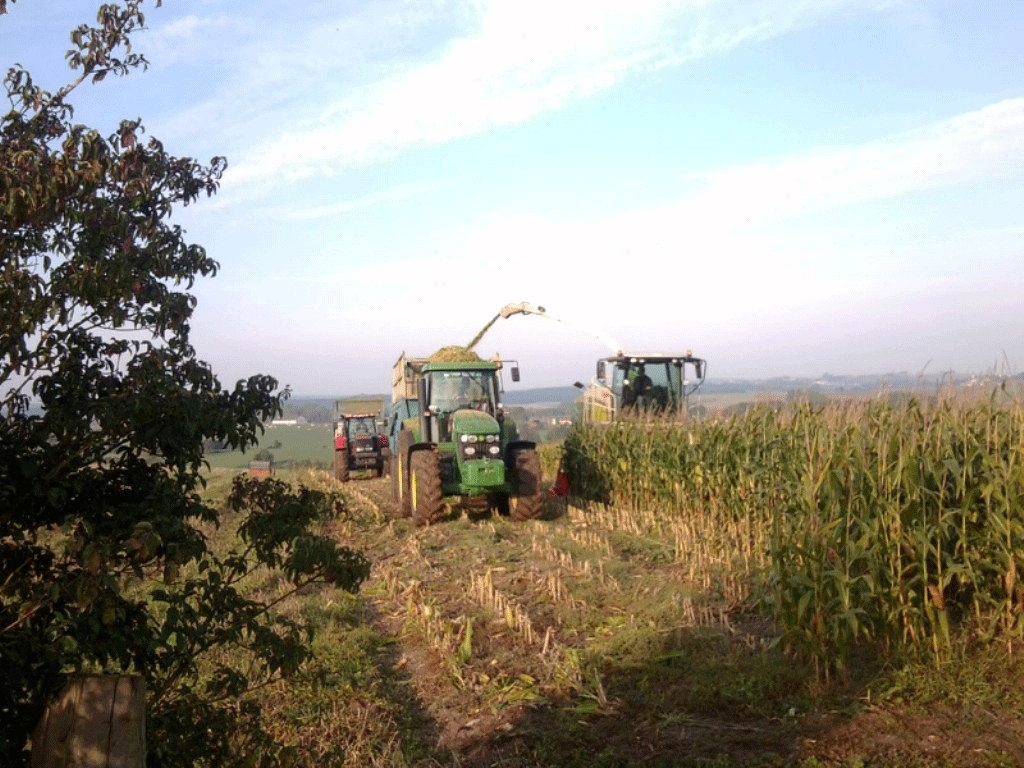
Giriviller - la Chamagne - Septembre 2013
Le maïs (Zea mays), ou blé d’Inde au Canada, est une plante herbacée tropicale vivace de la famille des Poacées (graminées), largement cultivée comme céréale pour ses grains riches en amidon, mais aussi comme plante fourragère. Le terme désigne aussi le grain de maïs lui-même, de la taille d’un petit pois.
Cette espèce, originaire du Mexique, constituait l'aliment de base des Amérindiens avant l'arrivée en Amérique de Christophe Colomb. La plante fut divinisée dans les anciennes civilisations d’Amérique centrale et méridionale, et était connue chez les tribus d’Amérique du Nord comme l’une des trois sœurs. Introduite en Europe au XVIe siècle, elle est aujourd’hui cultivée mondialement et est devenue la première céréale mondiale devant le riz et le blé. Avec l’avènement des semences hybrides dans la première moitié du XXe siècle, puis des semences transgéniques récemment, le maïs est devenu le symbole de l’agriculture intensive en Europe de l'Ouest, aux États-Unis et en Chine, mais il est aussi cultivé de façon très extensive dans l'Ouest de l'Afrique du Sud ou semi-extensive en Argentine et en Europe de l'Est.
Ensilage
L'ensilage est une méthode de conservation du fourrage par voie humide passant par la fermentation lactique anaérobie. En fonction des différentes techniques utilisées, on obtient un fourrage acide dont le pourcentage d'humidité varie de 50 % à 85 % environ. En règle générale, plus le taux de matière sèche est élevé, plus l'anaérobiose nécessaire au démarrage de la fermentation lactique est difficile à mettre en œuvre. Il a permis l'industrialisation de l'agriculture et l'élevage dense, hors sol. Il est devenu au XXe siècle un élément essentiel des systèmes de polyculture-élevage.
Il existe plusieurs voies de stockage et de conservation des fourrages :
- la voie sèche, dont le résultat est le foin. La conservation est rendue possible par la dessiccation, soit uniquement sous l'action du soleil (séchage naturel), soit complétée par de l'air chaud produit par des brûleurs (séchage en grange) conduisant à un pourcentage d'humidité du fourrage autour de 15 % qui assure sa stabilité.
- la voie humide, dénommée « ensilage », qui s'applique tant aux graminées fourragères qu'au maïs et éventuellement à des sous-produits agro-alimentaires comme la pulpe de betterave, les drêches de brasserie, etc. Elle est cependant difficile à réussir avec certains fourrages comme la luzerne, pauvre en sucres solubles et riche en azote (cf. mauvaises odeurs).
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 162 autres membres




